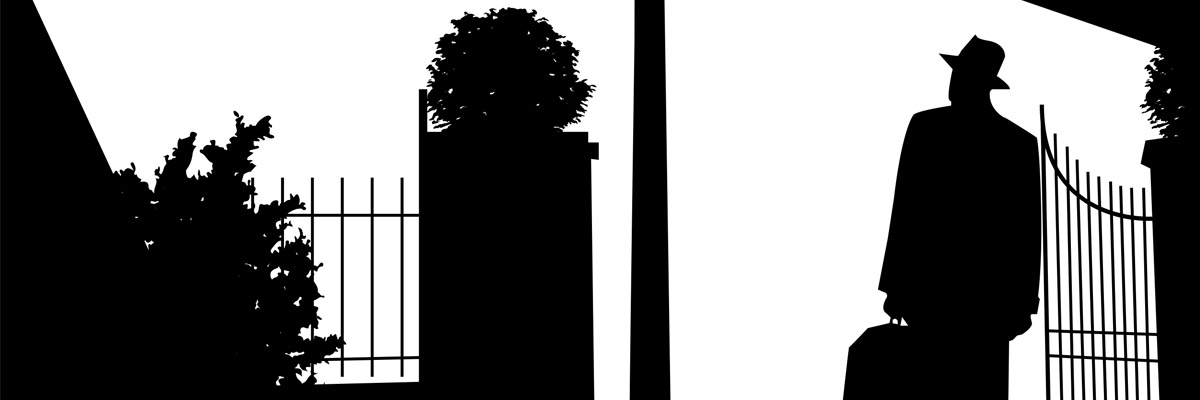Publié en 1971, le roman The Exorcist de William Peter Blatty trône au sommet des listes des meilleurs vendeurs. Pourtant, Hollywood ne se précipite pas pour en acheter les droits. D’une part, le sujet au cœur du récit, la possession et l’exorcisme d’une préadolescente, rend frileux les studios. Ensuite, Blatty exige de non seulement en faire l’adaptation (après tout, il est un scénariste établi), il veut également en être le producteur. C’est finalement la Warner qui décide de se commettre. Pour Blatty, le chemin de croix ne fait que débuter.
Plusieurs réalisateurs sont sollicités, dont Mike Nichols (The Gradutate, ou Le Lauréat), qui ne croit pas être en mesure de trouver une jeune comédienne capable d’incarner le rôle de Regan. Stanley Kubrick n’est tout simplement pas intéressé et John Boorman (Deliverance, ou Délivrance), en plus de décliner l’offre, suggère au studio de ne même pas faire le film. Ironiquement, il tournera la suite, mal accueillie, en 1977. La Warner trouve son homme en Mark Rydell, un réalisateur vétéran qui provient de la télévision. Blatty s’y oppose, lui préférant William Friedkin, une connaissance, dont il a vu le nouveau film à paraître : The French Connection (La Filière française). Impressionné par le résultat, Blatty est convaincu que l’approche quasi documentaire, genre dans lequel a baigné le réalisateur, conviendrait bien au ton voulu pour sa vision du film. Finalement, le film de Friedkin connaît un immense succès aux guichets en plus de remporter l’Oscar du meilleur film en 1972. Il obtient donc le contrat qu’il s’empresse d’accepter, ayant adoré le roman et étant excité d’affronter les énormes défis que pose la production.
En effet, la crédibilité du film repose sur les épaules de la comédienne qui incarnera Regan. Il faut que le public puisse croire en sa transformation. La production considère d’abord Pamelyn Ferdin qui, malgré ses 13 ans, a une feuille de route impressionnante avec plusieurs rôles dans des séries télévisées. Mais c’est justement ce qui bloque Friedkin, qui aimerait un visage un peu moins connu. Apparemment que Janet Leigh n’aurait pas voulu que sa fille, une certaine Jamie Lee Curtis, auditionne. Finalement, Linda Blair se présente avec sa mère de manière non sollicitée lors d’une session de casting. Intrigué, Friedkin accepte de la voir et aussitôt, il remarque quelque chose en la jeune mannequin qui avait auparavant participé à plusieurs catalogues de J.C. Penny, Macy’s et Sears, en plus d’être le visage de la compagnie de jus de raisin Welch à la télévision. Friedkin admire sa candeur et sa franchise.
En ce qui concerne les rôles de Chris, la mère de Regan, et du père Karras, Blatty et Friedkin se butent au studio qui préfère obtenir des vedettes. Pour Chris, Blatty voudrait bien son amie Shirley MacLaine, mais Friedkin offre plutôt le rôle à la comédienne Carol Burnett, un anticasting s’il en est un! Mais les bonzes de la Warner s’y opposent. On choisit alors Ellen Burstyn, connue pour de petits rôles à la télé, et, malgré la réticence du studio, ce choix est concédé, faute d’alternative.
Voir L’Exorciste est rapidement devenu une expérience collective qu’on ne devait pas rater.
Pour le père Karras, la production a d’abord signé l’acteur Stacy Keach, une figure du théâtre new-yorkais des années 1960. Mais William Friedkin reçoit un appel de Jason Miller, un dramaturge et acteur peu connu qui devient une sensation sur Broadway alors que sa pièce, That Championship Season, commence à connaître un énorme succès. Elle remportera d’ailleurs un Tony Award et un prix Pulitzer. Miller avait rencontré le réalisateur après une prestation de sa pièce et celui-ci avait refilé à l’acteur un exemplaire du roman de Blatty. Miller est convaincu qu’il est l’homme pour jouer Karras alors que, comme le personnage, il a également étudié pour être prêtre et qu’il avait finalement abandonné suite à une crise de la foi. Friedkin lui dit que le rôle est déjà donné, mais le comédien insiste pour un essai devant la caméra, ce que le cinéaste consent à lui offrir. Et après avoir visionné les rushs d’une scène partagée avec Ellen Burstyn et une autre où l’acteur mène une messe, Friedkin est convaincu par la force tranquille qu’exhibe Miller. Le studio rachète donc le contrat de Keach.
Enfin, pour le rôle du vénérable prêtre Lankester Merrin, la Warner désire que ce soit Marlon Brando, ce que Blatty et Friedkin rejettent avec empressement, inquiets que l’acteur vienne prendre toute la place médiatique. Le producteur penche plus pour le vétéran Paul Scofield, gagnant d’un Oscar quelques années plus tôt pour son interprétation de Thomas More dans A Man for All Seasons (Un homme pour l’éternité). Friedkin se laisse plutôt convaincre par l’acteur fétiche d’Ingmar Bergman, Max von Sydow qui, difficile à croire vu l’incroyable boulot fait par l’équipe de maquillage, n’avait que 43 ans au moment du tournage.
Si la préproduction s’est avérée ardue, le tournage l’a été tout autant, alors que le budget initial de 4,2 millions a presque triplé, se chiffrant à 12 millions. Méticuleux, Friedkin tourne dans des conditions éprouvantes pour son équipe qui le surnomme même « Wacky Willy », Willy le fou braque, alors qu’il reprend parfois des séquences déjà filmées plus tard au cours de la production et, surtout, qu’il emploie des tactiques douteuses afin d’obtenir les réactions nécessaires de ses comédiens. Sur ce chapitre, Jason Miller fait souvent les frais du cinéaste. Pour la scène du vomi qui rejaillit sur Miller, Friedkin assure à l’acteur qu’il ne le recevra que sur sa poitrine, comme lors des répétitions. Mais pour la prise actuelle, le réalisateur lui envoie le vomi en pleine figure sans l’avertir. À l’écran, on voit donc la réelle réaction de dégoût de l’acteur! À un autre moment, le réalisateur tire tout près de l’acteur un coup de revolver chargé d’une balle à blanc afin de créer une réaction de stupeur. On dit aussi que Friedkin a giflé le père William O’Malley, un vrai prêtre et connaissance de Blatty qui incarne le père Dyer, lors de la scène finale avec le père Karras mourant. Le geste aurait indigné les membres croyants de l’équipe technique.
Dans le roman, la partie de l’exorcisme se déroule dans des températures froides. Ne reculant devant aucun obstacle, Friedkin fait construire un plateau réfrigéré à -29 degrés Celsius afin de voir l’haleine frigorifiée de ses comédiens. Afin de rendre crédible la transformation de Regan sous l’effet du démon, plusieurs trucages physiques ont été évidemment utilisés. C’était bien avant l’ère du numérique! Pourtant, malgré tout ce que l’on peut accomplir aujourd’hui, ces scènes demeurent encore très terrifiantes. La scène de la tête qui fait une rotation sur elle-même n’était ni dans le roman ni dans le scénario. C’est un ajout de Friedkin afin de provoquer une réaction de plus auprès du public après la scène du crucifix. Un mannequin a donc été fabriqué. Il semblait si réaliste qu’il a même rendu mal à l’aise Linda Blair! Cette dernière a aussi été doublée en partie par une comédienne un peu plus vieille, Eileen Dietz, qui a filmé une portion de la scène de la masturbation avec le crucifix. Elle a également prêté ses traits au visage du démon Pazuzu que l’on peut apercevoir de manière quasi subliminale à quelques reprises. Enfin, des tests ont été effectués afin de changer électroniquement la voix de Blair, mais les résultats n’étaient pas très concluants. On a donc engagé une actrice plus âgée, Mercedes McCambridge, une fumeuse compulsive à la voix râpeuse. Avant de faire une prise, elle grillait une cigarette et buvait un verre de whisky, le tout attachée à une chaise! Le tournage entier de la possession et de l’exorcisme, en ordre chronologique, a nécessité un mois de travail.
Ne croyant pas vraiment au potentiel commercial du film, Warner le sort sur une trentaine d’écrans seulement le 26 décembre 1973. Pris par surprise par les recettes, le studio réussit à offrir rapidement le film sur plus de 300 écrans, devenant le film le plus profitable de l’histoire pour le studio, avec des recettes de 112 millions, incluant le box-office international. Le film devient un véritable phénomène médiatique alors que les émissions de nouvelles diffusent de multiples reportages sur le film, dont les réactions du public. Celui-ci semblait pris d’une certaine hystérie jamais revue depuis, alors que certains spectateurs vomissaient et tombaient sans connaissance. Voir L’Exorciste est rapidement devenu une expérience collective qu’on ne devait pas rater, comme le seront Jaws (Les Dents de la mer) et Star Wars (La Guerre des étoiles) un peu plus tard. Il est indéniable que les protestations de l’Église ont également contribué à l’immense succès du film.
Cinquante ans plus tard, David Gordon Green tente de relever le même pari qu’il avait fait avec son Halloween en 2018 : offrir une suite satisfaisante à l’œuvre originale tout en relançant une franchise dormante. Tout comme Jamie Lee Curtis et sa Laurie Strode, Ellen Burstyn, maintenant âgée de 90 ans, reprendra son rôle de Chris MacNeil dans une nouvelle histoire qui partagera un lien avec le premier film. Pour l’instant, pas de confirmation quant à une éventuelle participation de Linda Blair. |
The Exorcist: Believer (L’Exorciste : le croyant) prend l’affiche le 13 octobre.